
Notre vision de l'histoire de la science est arrimée à des mythes et des symboles, à l'anecdote d'un Newton découvrant la loi de la gravité en souffrant de la chute d'une pomme sur sa tête, à la fugure d'un Einstein réduisant l'énigme de l'espace et du temps à l'aide d'une simple équation. Nous avons spontanément tendance à voir la temporalité de la connaissance scientifique comme faite de «longues périodes d'ignorance et de désarroi, ponctuées de temps à autre par un «Eurêka!» chaque fois qu'un penseur de génie parvient à assembler une pièce du puzzle».
L'objectif de l'auteur est ici de déconstruire cette vision encomiastique et de rétablir l'élaboration du savoir dans sa réalité itérative, un savoir lentement constitué par des gens ordinaires en prise avec des problèmes souvent prosaïques. Ainsi du chasseur-cueilleur, du marin, du géomètre, du mineur, du forgeron, des marchands et artisans en tous genres qui auraient eu une influence bien plus déterminante que les grands noms que la science a gardé dans l'élabration et la consignation du savoir. Avant le chimiste, il y a le parfumeur; avant le physicien, le maçon; avant le mathématicien, le comptable; avant l'océanographe, le pêcheur; avant l'astronome, le navigateur, qui tirait le sillage de sa route dans l'ordonnencement des étoiles.
Les savants de métier n'auraient fait que de s'appuyer sur ce vaste matériau accumulé peu à peu pour parvenir à leurs «découvertes décisives»: la «capacité de Newton à "voir plus loin" n'est pas tant la résultante du fait qu'il se soit "juché sur les épaules des géants", que du fait qu'il se soit hissé sur le dos de milliers de petits artisans anonymes et illettrés.» La science serait donc une œuvre bien plus collective qu'on ne le croit ou que l'on voudrait nous le faire croire.
Clifford D Conner remonte d'abord aux peuples primitifs, souvent réduits à d'imbéciles superstitieux. L'auteur démontre que bien au contraire, ils avaient des connaissances précises sur des centaines d'espèces de plantes et d'animaux, qu'ils avaient classifiées tels de grands encyclopédistes, avec des hiérarchies et des découpages subtils. La zoologie, la botanique ont été engendrées par ces peuples, Arborigènes, Inuits, Bushmen. De même, l'on sait aujourd'hui quelle influence décisive à eu la pharmacopée des Amérindiens sur le développement de la médecine, eux qui les premiers ont réussi à extraire le curare, la quinine, qui sont aujourd'hui parmi les substances de base commercialisées par les grandes firmes pharmaceutiques.
L'auteur s'en prend donc au mythe du miracle grec, qui coïncide avec la constrcution et la prise de positions discursives «scientifiques» par une élite intellectuelle qui auraient d'un seul coup investit et systématisé la raison. Or, l'on sait aujourd'hui que Pythagore ou Hypocrate n'étaient que des labels regroupant une école de pensée nourrie d'une foule de matériaux observatoires antérieurs.
L'alliance de la science et du capital
L'évolution lente et équilibrée entre la science et les métiers subit une rupture au XIXe siècle, quand la civilisation capitaliste se met en place. Cette rupture se caractériserait par une monopolisation du savoir scientifique par les grandes firmes privées, par la mise en parallèle de la production de la connaissance et des flux financiers, ce dont nous n'avons peut-être pas complètement conscience en France, où le savoir est longtemps resté l'apanage d'une recherche financée par les deniers publics. Pour Conner, «ce n'est plus la satisfaction des besoins humains mais la recherche du profit qui détermina la production du savoir scientifique aux XIXe et XXe siècle.» C'est la rationalité même de la production du savoir qui change: d'objective et désintéressée, la science serait de plus ne plus articulée à des intérêts privés et distribuée pour le profit de quelques uns seulement. Un constat qui invalide ainsi la thèse hégélienne d'un progrès continu de la raison dans l'Histoire pour le bien de l'humanité en son ensemble. Dominée par les experts et obsédée par la puissance, l’efficacité, la rationalisation, l’accumulation et le profit, la science est détournée de ses visées humanistes. Une «science lourde» apparaît.
L'histoirien prend l'exemple actuel du secteur de «la grande pharma» et des sciences médicales aux États-Unis. La mainmise du grand capital sur le savoir pharmaceutique engendrerait un manque de fiabilité total des études scientifiques produites: «Un quart des scientifiques travaillant dans la recherche médicale ont un lien financier avec l'industrie. Et sans surprise, les conclusions que les chercheurs tirent de leurs travaux sont fortement liés à leurs partenariats commerciaux». Aperçu du mécanisme : «de connivence avec des chercheurs universitaires en quête de subsides, certaines firmes pharmaceutiques, petites ou grandes, ont présenté des données scientifique biaisées, d'abord pour obtenir une autorisation réglementaire, ensuite pour inciter les médecins à prescrire leurs produits à des patients qui ne se doutent de rien». Clifford O. Conner dresse un constat sociologique simple: la privatisation du savoir par de grandes firmes privés l'évide de l'objectivité dont il est pourtant constitutivement censé faire l'objet. Plus que de rapports de vérité, le savoir pocéderait désormais de rapports de force économiques.
Dès lors, l'information médicale se changerait en simple marketing commercial : «Les revues médicales ont dégénéré en entreprises de blanchiment d'information pour l'industrie pharmaceutique (…), cela s'explique par le fait qu'elles appartiennent à des maisons d'édition scientifiques qui tirent d'énormes revenus des publicités des compagnies pharmaceutiques, et qui en sont demandeuses». Les opinions se vendent au plus offrant, le savoir est devenu une marchandise comme une autre, explique un scientifique américain. Un véritable négriat littéraire se met désormais en place, avec des figures discursives qui font autorité et qui se contentent de signer des articles qu'ils n'ont pas écrit, voire même lu.
Quid des instances de contrôle et de régulation, des organismes publics? Aux États-Unis, c'est l'Administration du contrôle alimentaire et pharmaceutique qui est censée veiller aux respect des normes sanitaires. Las, elle est «devenue une agence où les conflits d'intérêt sont devenus la norme», par l'intermède des différents lobbies notamment. Bien souvent, les experts censés garantir le respect de l'intérêt général sont aussi salariés par des labos privés et soumis à leurs intérêts particuliers, une situation dont l'affaire Servier a par ailleurs dévoilé la réalité en France. La régulation viendrait plutôt de l'action «par le bas», soit d'organisations non-gouvernementales soit de journalistes d'investigation indépendants; d'après l'auteur, c'est à eux que l'on doit d'avoir révélé la plupart des scandales sanitaires.
L'historien termine son panorama socio-historique par une analyse de la révolution numérique et des autoroutes de l'information qu'elle a dessiné. Il rappelle que «les programmeurs sont les artisans, les ouvriers, les bâtisseurs et les architectes de la société de l'information», dont le développement, encore aujourd'hui, procède des démarches itératives de l'individu lui-même et lui rendent une certaine autonomie. En informatique, la pratique semble plus décisive que la théorie. La programmation et le logiciel restèrent ainsi, des années durant, «le domaine de personne en marge du monde scientifique»; d'ailleurs, aux premiers temps de l'informatique, les ingénieurs vouaient un mépris indifférent aux programmeurs. Les langages «évolués» utilisés en informatique, comme le Fortran, le Cobol ou plus tard le Basic, rendirent peu à peu l'informatique accessible à un nombre croissant de non-spécialistes. Internet a été le lieu d'un savoir populaire et ouvert, dont témoigne aujourd'hui le développement des logiciels libres (qui commença au début des années 1990), qui ont la particularité de procéder à partir d'un code ouvert, c'est-à-dire lisible et amendable par tous. Pour Richard Stallmann, créateur de la Fondation pour le logiciel libre, «la conclusion était que le logiciel propriétaire était une mauvaise chose, qui désunit les gens et les maintient dans l'impuissance».
Au moment de conlure, Clifford D. Conner demeure cenpendant prudent: «c'est trop attendre d'une technologie que d'espérer que la prolifération des ordinateurs mènent à une quelconque libération». D'après, lui la technologie internet a été rapidement colonisé par les intérêts mercantiles des grands monopoles médiatiques. Elle aurait d'ailleurs plutôt servi à créer de nouvelles manières de travailler et de consommer que provoquer un réel renouvellement de l'engagement politique.
Au moment où il rédigeait son livre, les révolutions arabes, qui ont apporté un nouvel éclairage sur les potentialités politiques des micro-technologies de l'information, n'avaient cependant pas encore eut lieu.
---------------
Clifford D. Conner, Histoire populaire des sciences, Ed. L'échappée, Paris, 2011, 560 p., 28 euros.










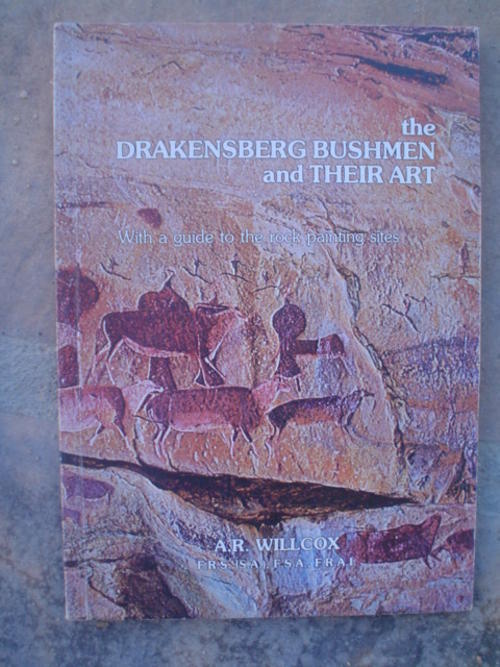



 GAGNÉ Natacha, MARTIN Thibault, SALAÜN Marie,
GAGNÉ Natacha, MARTIN Thibault, SALAÜN Marie,

 12 euros, 312 pages, 1994
12 euros, 312 pages, 1994  16 euros, 606 pages, 1989
16 euros, 606 pages, 1989










