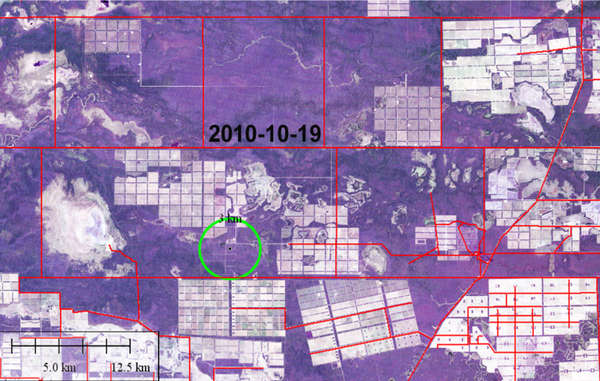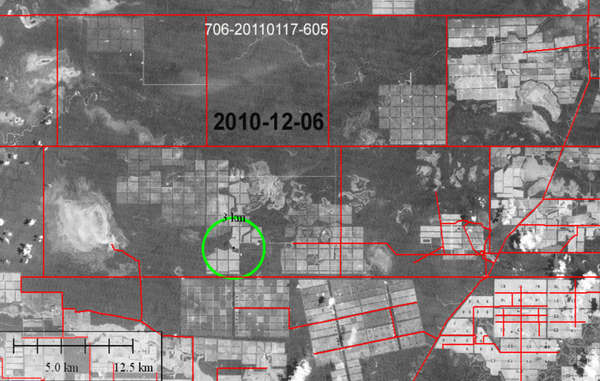Femme au parcours exceptionnel - entre le foisonnement intellectuel de la Californie des années 1970 et le désert australien - Sylvie Crossman est aujourd'hui éditrice et écrivain. Rencontre avec cette passionnée des sociétés aborigènes dont le dernier roman 'Soeurs de peau' résonne comme un hommage.
Normalienne, elle a fréquenté Henry Miller qui lui a même dédicacé un ouvrage. Elle a été correspondante auMondeen Australie, commissaire d'exposition, éditrice, écrivain ( 'Le Nouvel Age' au Seuil), etc. Ainsi, interviewer Sylvie Crossman , c'est un peu comme côtoyer l'espace d'un instant la diversité, la curiosité et l'intelligence. Enthousiaste et éloquente lorsqu'elle parle des sociétés aborigènes, elle n'en reste pas moins exaltée au sujet de sa propre vie. Le personnage est à la hauteur de son roman, juste, charismatique et sincère.
C'est dans un hôpital de brousse en plein coeur de l'Australie que commence votre amour de la culture aborigène ?
J'ai créé le poste de correspondant duMondeà Sydney. Mon époux(Jean-Pierre Barou, ndlr)et moi avons visité avec notre fils le désert afin de rencontrer les aborigènes. Nous avons eu un très grave accident de voiture que je raconte en partie dans mon livre. Le soir les aborigènes - qui refusaient les soins - reprenaient l'hôpital en main avec des cérémonies. Ce fut une introduction très forte dans la culture de ce peuple. A notre sortie, nous avons eu envie de retourner dans le désert.Les grands initiés ont accepté pour la première fois de révéler les secrets, les signes sacrés qui pour eux sont des actes de propriété sur la terre. C'est la plus vieille tradition picturale au monde. Ils l'ont fait pour lutter, dans les années 1970, contre une tentative d'assimilation du gouvernement qui essayait d'extirper la racine noire de ces populations.Les aborigènes ont accepté de peindre sur nos propres supports - des toiles avec de l'acrylique - leurs secrets ancestraux. A ce moment d'appauvrissement de l'art contemporain, les marchands d'arts ont considéré cet art aborigène comme de l'art abstrait et l'ont invité sur le marché. En France, on a organisé une première exposition d'art aborigène au musée Fabre à Montpellier. Elle a eu un succès fou. Mais loin d'être uniquement esthétique, on apprend qu'au-delà de la mémoire, ces oeuvres révèlent des savoirs. Elles sont des mains tendues vers nous, censées enseigner les choses différemment. Après une série d'expositions, nous avons décidé de créer, en septembre 1996, les éditions Indigène, pour publier les catalogues.
Pourquoi le terme "indigène" est-il aujourd'hui considéré comme péjoratif ?
Il peut être contesté. Mais à l'époque on l'a utilisé à la manière des Anglo-Saxons, à savoir "qui viennent de la terre". Pour reprendre les mots de mon ami Jean Lacouture , on a"redonné une noblesse au motindigène". Je n'ai jamais eu de sentiments négatifs face à ce terme.
Votre roman évoque la condition des aborigènes en Australie. Comment pourrait-elle se définir ?
Aujourd'hui, c'est probablement le peuple "premier, le plus radicalement opposée au mode de vie et de développement des Occidentaux. Pour eux, être au monde, c'est être nomade et créer. Ils pensent que nous vivons dans un monde qui est une création. Leur mission est de suivre les pas de ce créateur et de préserver ce capital de beauté, de richesses et de plénitude dont ils ont hérité. Ces sociétés sont dans une autre réalité que la nôtre. Elles ne sont pas dans un avant du monde occidental.
Vous auriez pu écrire un essai. Pourquoi préférer le roman ?
La réalité aborigène est tellement peu connue que l'on pourrait s'imaginer que c'est un roman ethnographique, le roman d'une culture. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut le percevoir. Tout d'abord, on ne peut entrer en contact avec eux qu'en s'immergeant dans une forme artistique.Le roman offre, par sa plasticité, un terrain dans lequel on peut tester de nouvelles connexions de consciences. Et le roman contemporain permet la mise en scène de la conscience. Yourcenar disait"Dans le roman on essaie de faire de la magie sympathique", c'est-à-dire se transposer en conscience à l'intérieur de quelqu'un.Moi, je ne pouvais rentrer en contact, développer un lien sincère avec les aborigènes qu'à travers la forme romanesque. En réalité, ces personnages sont violemment romanesques. Aujourd'hui dans le désert, il y a encore des crimes rituels, des histoires fortes, des destins singuliers. A l'inverse de l'essai, le roman permet de rentrer en émotion avec quelqu'un, dévoilant ainsi quelque chose de la conscience.
Vous faites preuve d'empathie...
Il y a une sorte de "sous-texte" au roman. Le personnage de Sarah est également dans une histoire à la recherche d'une issue. Il y a des problématiques dans ma vie et même dans mon travail d'auteur qui se sont dénouées grâce à ce roman. Des personnages de ce roman m'ont pris la main comme Ruby ou Emily. J'ai eu beaucoup de mal à écrire un peu comme une expérience douloureuse qui en définitive m'a transformée. Essayer d'entrer en connexion avec des êtres aussi éloignés dans l'espace mental que les aborigènes me semblait être un beau défi romanesque.
Votre écriture relie également l'immanence de la nature et des corps à la transcendance du sacré cérémonial ou de l'équivoque de la sensualité ?
L'immanence est la grande définition de ces sociétés. Elles sont "en soi", elles ne sont pas dans une distanciation, dans un dédoublement.C'est ce qui entretient la difficulté de percevoir ces cultures "premières" dans leur spécificité parce qu'elles sont en actes en permanence.Un aborigène est aussi bien dans le présent, dans le passé que dans le futur. Leur notion de temps est beaucoup plus vaste que chez nous. Le présent ne vaut pour eux que validé, fondé par le passé.
C'est un roman sur la liberté mais à travers la figure féminine ?
Je pense que les femmes, par leur ancien statut de minorité, sont plus dans une recherche d'intériorité aux dépens de valeurs extérieures - le pouvoir, l'argent, les lois du sang - qui limitent le cheminement intérieur. La femme, en rupture socialement avec ces valeurs et encline à une démarche d'intériorité, offrira plus aisément cette liberté et cette reconquête. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus à prouver leur égalité avec les hommes. Elles cherchent plutôt à fonder quelque chose à partir de valeurs spécifiquement féminines.
L'art est important dans votre roman, une manière pour les aborigènes de révéler la richesse de leur culture. Ne craignez-vous pas qu'il y ait une réappropriation de cet art sacré par le regard purement esthétique de l'Occidental ?
Il y a eu des débats extrêmement complexes dans les sociétés aborigènes à ce sujet. Les premières oeuvres montrées étaient publiques, elles se réalisaient en dehors des cérémonies secrètes accessibles aux seuls initiés.En réalité, on ne peut voir que ce que l'on sait voir. Un profane qui regarde une oeuvre sacrée ne perçoit que l'apparence. S'il n'a pas les codes, les clés, il n'en reste qu'à une vision esthétique, superficielle.D'une certaine manière, ça protège le sacré et le mystère des oeuvres aborigènes. Le plus important reste l'autorisation qui est donnée par un aîné lors du cérémonial de l'initiation. En plus de recevoir la charge de protéger la terre, on lui dévoile le motif sacré, correspondant à cette propriété et équivalant à une autorisation. Beaucoup d'anthropologues pensent que certaines oeuvres - comme elles sont réalisées sur des toiles avec de la peinture acrylique, par exemple - ne sont pas authentiques. Jamais un aborigène ne dirait cela. Pour lui, à partir du moment où le signe existe, l'oeuvre est authentifiée par le motif de la transmission et de l'autorisation. Ce qui prouve encore l'audace de ces sociétés qui ne sont ni froides ni figées.
Vous ne devez pas aimer les caricatures exotiques ou le folklore autour de la culture aborigène ?
Longtemps, on a entretenu cette rupture erronée entre le monde occidental censé incarner la raison et les sociétés aborigènes rivées à une pratique du surnaturel. Pourtant pour survivre dans le désert, il faut un maximum de raison. Ce qui est fascinant aujourd'hui, ce sont ces dialogues entre les grands initiés et nos scientifiques, notamment en matière de neurologie. On a par exemple prouvé scientifiquement qu'avec la méditation, on pouvait contrôler son système immunitaire. Des travaux récents de neurologie ont démontré que si la partie émotionnelle du cerveau est entravée, cela a des conséquences graves sur la prise de décisions. Ainsi, la scission entre l'émotion et la raison est encore désavouée. Dans ces sociétés aborigènes, on ne remplit pas sa conscience, on ne la bourre pas de savoirs, mais on la cultive comme on travaillerait un muscle pour qu'elle soit en capacité de ressentir, d'éprouver et d'agir de la manière la plus vaste possible. La conscience est mise en condition de recevoir le monde.
Que voulez-vous dire aux lecteurs avec ce roman ?
Que ce n'est pas un roman exotique. C'est l'histoire de deux femmes dans le désert australien. Un désert qui a autant de réalité que le macadam parisien. Il est vaste et en même temps porteur car il appelle à une réévaluation de nos valeurs, de nos modes de vie. Aujourd'hui, on a besoin de réunifier les consciences. Il n'y a pas de hiérarchie - comme le font croire la politique, l'art ou la religion -, le monde est une vaste unité, une communauté de consciences. Si les gens arrivaient à dialoguer de conscience à conscience, on serait dans un monde un peu plus ouvert à la hauteur de l'humain...