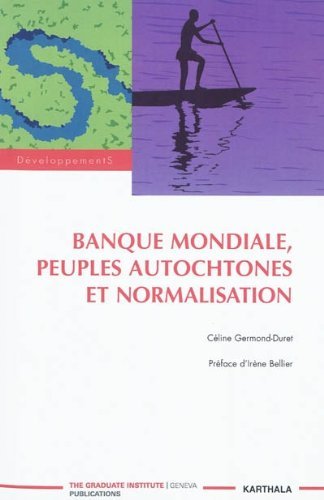Dans sa langue natale, son nom signifie ‘Faucon’. Cependant, même avec l’acuité visuelle que ce nom évoque, Karapiru n’aurait jamais pu prévoir la tragédie qui s’est abattue sur son peuple, la tribu awá du nord-est du Brésil. Il n’aurait jamais pu imaginer que ce jour-là il devrait fuir et s’enfoncer dans la forêt pour sauver sa vie, une balle lui brûlant le dos, sa famille décimée par des hommes de main armés. Il n’aurait pas pu non plus se douter que ce jour violent serait le premier d’une décennie de solitude et de silence.
La terre ancestrale de Karapiru se trouve dans l’Etat du Maranhão, bordée à l’ouest par les denses forêts amazoniennes et à l’est par le Cerrado, une savane riche en biodiversité. Pour les Awá, la terre n’a qu’un seul nom : Harakwá, ou ‘l’endroit que nous connaissons’.
Les 460 membres de la tribu awá vivent principalement de la chasse (pecari, tapir ou singe) et de la cueillette (baies, fruits et noix sauvages). Ils se nourrissent aussi de miel qu’ils récoltent dans les nids d’abeilles perchés au sommet des grands arbres. Les chasseurs se déplacent dans la forêt avec des arcs de près de deux mètres de long, souvent la nuit, en éclairant le chemin à l’aide de torches faites de résine d’arbre. Mais toute nourriture n’est pas bonne à prendre, ainsi le vautour, la chauve-souris ou le paresseux à trois orteils, sont interdits.
Les Awá élèvent beaucoup d’animaux de compagnie, souvent les petits des animaux qu’ils viennent de chasser devenus orphelins et ils partagent leur hamac avec les coatis et leurs mangues avec les perruches vertes. Les femmes nourrissent même au sein les singes hurleurs et les capucins et sont réputées pour allaiter de petits cochons.
L’année awá est divisée en saisons des ‘pluies’ et de ‘soleil’. La pluie est contrôlée par des créatures célestes, les ‘maria’ qui sont les maîtres de grands réservoirs dans le ciel. Quand la lune est pleine, les hommes, leurs cheveux noirs tachetés de blanc par du duvet de vautour royal, communient avec les esprits par des chants qui les amènent dans un état de transe, lors d’un rituel sacré qui dure jusqu’à l’aube.
Pendant des siècles, leur mode de vie a été en parfaite symbiose avec la forêt tropicale. Puis, au cours de quatre décennies, ils ont été témoins de la destruction de leur terre natale – plus de 30% de l’un de leurs territoires a été rasé – et du meurtre de leur peuple par les karaí, ou non-Indiens. Aujourd’hui, ils sont non seulement l’une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs du Brésil, mais également l’une des tribus les plus menacées au monde.
La terrible histoire de Karapiru a véritablement commencé il y a 45 ans avec une découverte due au hasard, lors d’une étude aérienne des ressources minérales de la région effectuée par des géologues nord-américains. Lorsque l’hélicoptère eut besoin de faire le plein, le pilote décida d’atterrir sur un haut sommet dénué d’arbres des monts Carajás. L’un des géologues remarqua des pierres gris-noir sur le sol qu’il reconnut aussitôt comme étant du minerai de fer. En réalité, sous ses pieds, le sol était jonché de ce qu’un magazine de géologie désignerait plus tard comme ‘une couche épaisse de Jaspilite et des lentilles d’hématite dure’. Pour les profanes, cela signifie que les prospecteurs venaient de mettre la main sur l’un des dépôts de fer les plus riches de la planète.
Leur découverte donna rapidement lieu à un gigantesque projet de développement, le Projet Grand Carajás, financé par les Etats-Unis, le Japon, la Banque mondiale et la CEE. Il englobait un barrage, une fonderie d’aluminium, des usines de production de charbon de bois et des fermes d’élevage de bétail. Les routes qui furent ouvertes détruisirent des pans entiers de forêt primaire et une voie ferrée de 900 kilomètres qui traverse le territoire awá pour atteindre la côte fut construite pour transporter les ouvriers et le minerai. Mais le joyau de ce titanesque projet industriel était un immense gouffre creusé dans le sol – si grand qu’il pouvait être vu de l’espace – et qui deviendrait, avec le temps, la plus grande mine à ciel ouvert du monde.
Le Projet Grand Carajás était dévastateur pour l’environnement et les Indiens qui vivaient dans la région, en dépit du fait qu’en échange d’un prêt d’un milliard de dollars, les financeurs avaient demandé au gouvernement brésilien de garantir que les territoires indigènes seraient délimités et protégés.
Mais il y avait une fortune à tirer de la forêt qui fut vite envahie par une ruée de colons de toutes sortes, d’éleveurs et de bûcherons. Des excavateurs gigantesques creusaient la terre, déchirant les couches de sol et de pierres pour atteindre le minerai, bauxite et manganèse. Les rivières furent contaminées et des arbres centenaires furent abattus et brûlés. Le noir de la cendre de charbon avait remplacé le vert profond du feuillage de la forêt : Harakwá est devenu une représentation polluée, traumatisante et boueuse de l’enfer.
Pour les prospecteurs, les Awá n’étaient rien de plus qu’un obstacle entre eux et ce trésor ; une nuisance primitive qui devait tomber en même temps que les arbres. Les Awá étaient pris en étau entre eux et les dollars que les cailloux généreraient.
Ils ont donc entrepris de les anéantir.
Pour arriver à leurs fins, certains étaient très inventifs : plusieurs Awá sont morts après avoir ingurgité de la farine mélangée à un insecticide anti-fourmi, ‘cadeau’ d’un fermier local. D’autres n’hésitaient pas à tirer sur les Indiens, là où ils se trouvaient – à la maison, devant leurs familles, Karapiru en a été victime.
Karapiru croyait qu’il était le seul membre de sa famille à avoir survécu à ce massacre. Les assassins avaient tué sa femme, son fils, sa fille, sa mère, ses frères et ses sœurs. Un autre de ses fils avait été blessé et capturé.
Profondément traumatisé, Karapiru s’échappa dans la forêt, une charge de grenaille de plomb dans le bas de son dos. ‘Je n’arrivais pas à guérir ma blessure. Je ne pouvais rien mettre dessus et je souffrais beaucoup’, a-t-il raconté à Fiona Watson, de Survival. ‘Les plombs me brûlaient le dos et je saignais abondamment. Je ne sais pas comment ma blessure ne s’est pas infectée. Mais j’ai réussi à échapper aux Blancs’.
Au cours des dix années qui suivirent, Karapiru n’eut de cesse de fuir. Il marcha plus de 600 kilomètres à travers les collines boisées et les plaines de l’Etat du Maranhão, traversant les dunes de sable des restingas et les larges cours d’eau qui abondent dans la région.
Il était terrifié, affamé et seul. ‘C’était très dur’, a-t-il raconté à Fiona Watson, ‘Je n’avais pas de famille pour m’aider et personne à qui parler’. Il réussit à survivre en mangeant du miel et de petits oiseaux, des perruches, colombes et grives à ventre rouge. La nuit, lorsqu’il dormait dans les hautes branches des grands copaiba, parmi les orchidées et les lianes, il entendait le cri des singes hurleurs dans la canopée. Et quand le chagrin et la solitude devenaient trop pesants – ‘parfois je n’aime pas me rappeler tout ce qui m’est arrivé’ – il se parlait doucement à lui-même, ou fredonnait pendant qu’il marchait.
Plus d’une décennie après avoir assisté au meurtre de sa famille, Karapiru a été surpris par un fermier à la périphérie d’un village dans l’Etat voisin de Bahia. Il marchait dans une parcelle de forêt qui avait été brûlée, en portant une machette, quelques flèches, des récipients d’eau et un gros morceau de cochon sauvage boucané.
Karapiru suivit le fermier jusqu’au village, où il trouva refuge chez un homme en échange de menus travaux. La nouvelle se répandit vite qu’un homme solitaire, un Indien ‘inconnu’ qui parlait une langue que personne ne comprenait, était sorti de la forêt.
Il était un homme qui avait passé dix ans à ‘fuir de tout’ sauf de son chagrin. ‘J’étais très triste’, raconte-t-il. Mais tout comme il n’aurait jamais pensé qu’il endurerait de longues années de souffrance, ‘Faucon’ ne pouvait prévoir le bonheur qu’il ressentirait bientôt.
A suivre… (2 vidéo sur le site de Survival)
Par Joanna Eede